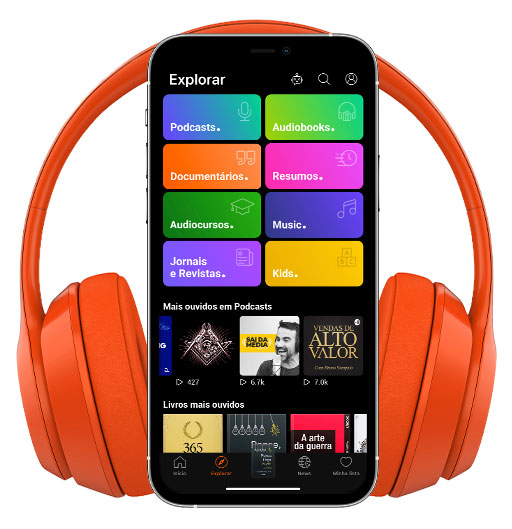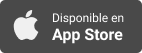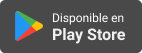Informações:
Sinopsis
Une émission de l’AIU, préparée et présentée alternativement par Frédérique Leichter-Flack et Ariel Danan le dimanche 13h30-14h.« Le bénéfice du doute » abordera chaque semaine une problématique différente, en prise avec les enjeux du moment mais à distance cependant des discours tranchés de lactualité immédiate. En compagnie dun invité – philosophe, sociologue ou historien, juriste, économiste ou médecin, du monde des idées ou de la société civile – on tentera ensemble le questionnement éthique propre à rendre complexité à la décision, prudence à laction et fondement au discours. Manière de revendiquer la pertinence du dialogue qui peut se nouer, sur le terrain des valeurs, entre les humanités juives et le temps présent en accordant, le temps dune discussion, à chaque question le bénéfice du doute.
Episodios
-
« Sur le Sacrifice »
18/09/2016De l’engagement sacrificiel et altruiste pour de nobles idées, au martyre meurtrier qui fait aujourd’hui tant de victimes innocentes, qu’est-il donc arrivé à l’idée de sacrifice ?
-
« Pourquoi, au juste, punit-on le racisme en France ? »
11/09/2016La prolifération des discours de haine sur internet et sur les réseaux sociaux pose de nouveaux défis que nos lois sur le racisme et l’antisémitisme ont du mal à relever. D’autant que, sur ce terrain du racisme, la limitation très stricte de la liberté d’expression qu’on trouve dans le droit français est une véritable exception à l’international. Contre les discours de haine, faut-il faire confiance à la liberté d’expression, ou l’encadrer davantage ? Mais au fait, pourquoi au juste punit-on le racisme en France ? Les lois Pleven de 1972 et Gayssot de 1990, qui limitent la liberté d’expression dès lors qu’il est question de racisme et d’antisémitisme, ont-elles été justifiées de manière suffisamment solide ? Ou la confusion actuelle tiendrait-elle à une mauvaise justification intellectuelle de notre choix de pénaliser le racisme ?
-
« Le terrorisme, entre histoire et mondialisation »
04/09/2016Comment le terrorisme s’est-il imposé dans les relations internationales ? Parle-t-on bien partout de la même « terreur » ou les malentendus et ambiguïtés sur la définition et l’interprétation du phénomène, ici et là, sont-ils constitutifs de la mondialisation ? Jenny Raflik, historienne, est maître de conférences à l’Université de Cergy. Elle est l’auteur de Terrorisme et mondialisation, paru en 2016 aux éditions NRF Gallimard, lauréat du prix Emile Perreau-Saussine 2016 pour les sciences humaines et la philosophie politique.
-
« A propos de Shoah de Claude Lanzmann »
03/07/2016La sortie du film Shoah en 1985 fut un véritable événement historique, cinématographique, et philosophique. Accompagnée du discours tenu sur elle par son auteur Claude Lanzmann, au travers des différentes polémiques qui ont entouré sa réception, l’œuvre s’est imposée comme un paradigme incontournable, notamment dans le champ de l’éthique du témoignage. Elle a aussi installé dans le paysage français et occidental l’usage d’un terme hébreu étrange, « Shoah », contre celui d’ « Holocauste » en circulation aux Etats-Unis, contre aussi le concept d’ « Auschwitz », un temps mobilisé parmi les penseurs occidentaux pour universaliser l’expérience limite de la condition humaine qu’on a voulu déchiffrer au travers du camp. Trente ans après sa sortie, peut-on faire un bilan de l’événement Shoah dans le champ de l’histoire des idées comme dans celui du cinéma?
-
« Droits de l’homme et Judaïsme »
26/06/2016Pour René Cassin, co-rédacteur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, prix Nobel de la paix, et ancien président de l’Alliance Israélite Universelle, le combat pour la reconnaissance universelle des droits attachés à l’être humain en tant que tel, la défense des valeurs de la République française, et la lutte contre l’antisémitisme, allaient de pair. Mais que signifie la solidarité de ces causes et que donne-t-elle à penser ? Si la source juive a inspiré la pensée des droits de l’homme, par l’intermédiaire des notions de liberté, d’égalité de valeur des vies, de dignité de l’être humain, fondamentales dans la pensée biblique et rabbinique, cette filiation dans l’histoire des idées doit-elle être réexaminée ? Faut-il, et comment, remobiliser les affinités entre judaïsme et droits de l’homme? Telles sont les questions que nous discutons dans cette émission avec Yeshaya Dalsace, rabbin de la communauté massorti Dor Vador à Paris.
-
« L’intelligence artificielle, un nouveau projet démiurgique ? »
19/06/2016L’intelligence artificielle est aujourd’hui déjà presque partout, des moteurs de recherche aux logiciels de traduction automatique ou de reconnaissance faciale, en passant par les voitures sans chauffeur ou les robots d’accompagnement domestique sur le point d’entrer dans nos vies pour veiller sur nos enfants ou sur nos aînés. Mais les progrès récents des machines auto-apprenantes, comme le programme Alphago désormais champion du monde de jeu de Go, nous ont-ils fait franchir un seuil dans l’histoire de l’évolution d’Homo Sapiens ? Faut-il craindre le fantasme transhumaniste de « l’homme augmenté » ? Et que penser des alertes à propos des usages militaires de l’intelligence artificielle et des armées de « robots tueurs » auxquels on pourrait faire mener nos guerres de demain ? Peut-on donc confier à l’intelligence artificielle des décisions d’ordre moral ? Ou les questions posées sous cette forme sensationnaliste dissimulent-t-elles les véritables enjeux éthiques et politiques dont un débat démocratique devra
-
« Le fou de Dieu. Lire et enseigner l’épisode de la ligature d’Isaac aujourd’hui »
05/06/2016Que faire de tous ces passages violents, dans les textes sacrés ? De ces récits et ces prescriptions qui heurtent aujourd’hui nos réflexes éthiques et notre conscience humaniste ? La réponse juive tient généralement en un mot : le commentaire. Entre la lecture littérale de la Bible, et le message à en tirer pour savoir comment vivre, c’est le travail de l’interprétation qui déjoue les logiques fanatiques et réinjecte l’exigence éthique, cette exigence éthique qui, à travers les siècles, a toujours accompagné la tradition talmudique. Mais il est un passage qui condense toutes les difficultés : c’est le récit, en Genèse 22, de la ligature d’Isaac. Comment lire, et enseigner aux jeunes, aujourd’hui, ce récit fondateur dans lequel le père des trois monothéismes n’hésite pas à lever le couteau sur son propre fils pour obéir à ce qu’il entend comme un ordre de Dieu ? Que faire d’une telle obéissance, et quel rapport moral entretenir avec ce modèle ? Ce sont les questions que nous discutons, dans cette émission, ave
-
« Droits de l’homme et diplomatie »
29/05/2016Que signifie, sur le terrain, le combat pour l’universalisme des droits de l’homme ? Comment déjouer le relativisme culturel qui dénie à certains êtres humains, au prétexte de leur appartenance culturelle ou religieuse, le droit aux droits de l’homme ? Faut-il relever le défi du multilatéralisme, malgré le découragement qu’on peut éprouver quand on voit le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU détourné par les pires tyrans de la planète ? Et le lien éthique profond entre judaïsme et droits de l’homme doit-il être réactivé, selon le modèle de René Cassin, pour inspirer de nouvelles mobilisations ? Telles sont les questions que nous discutons dans cette émission avec François Zimeray, ancien ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme. Dans J’ai vu partout le même visage (éd. Plon), François Zimeray raconte, en une série de brefs chapitres souvent émouvants, les rencontres et scènes vécues au cours des années consacrées à parcourir le monde au nom de la diplomatie française des droits de l’homme. Il y évo
-
Raconter la vie des autres : « un projet de démocratie narrative »
22/05/2016La collection de petits livres « raconter la vie », qui paraissent régulièrement depuis janvier 2014 au Seuil, offre une série d’enquêtes et surtout de témoignages, pour rendre compte de l’expérience de vie de ces gens dont la voix n’est pas entendue aujourd’hui dans la société française, et que la représentation nationale connaît trop mal. C’est le « Parlement des invisibles », selon l’expression de Pierre Rosanvallon : le projet éditorial a une ambition à la fois sociale, politique, et morale, et une grande diversité de formes : témoignages à la première personne co-rédigés avec l’aide d’un tiers, enquêtes sociologiques, récits de vies ordinaires par des écrivains célèbres… Mais comment raconte-t-on la vie des autres sans la trahir, sans la modeler selon nos attentes ? Peut-on témoigner pour autrui sans le transformer ? Sans le juger ? Et comment choisir ce qui est digne d’être raconté ? Quels enjeux éthiques derrière cet effort de « démocratie narrative »? Ce sont les questions que nous partagerons avec Pa
-
Comment parler d’Israël ? Les paradoxes de « l’Etat juif et démocratique »
15/05/2016S’il est un sujet dont il est devenu presque impossible de s’aventurer à parler sans savoir d’abord avec qui on parle, et très aventureux de le faire sans avoir une petite idée de ce qu’en pensent déjà nos interlocuteurs, c’est bien Israël. Discuter d’Israël, aujourd’hui, en France, c’est de moins en moins souvent chercher à décrire ou à comprendre, et plus en plus souvent, argumenter : chaque mot peut être mobilisé comme pivot pour remporter la bataille des idées ou retourné contre celui qui l’emploie. Comment fait-on pour parler d’Israël au milieu de tant d’idées reçues ? Comment trace-t-on son chemin, par-delà les camps retranchés, au milieu de tous ces arguments prêts à penser ? C’est à cette mission difficile que Denis Charbit s’est employé dans un livre précieux, Israël et ses paradoxes, qui fait le point, en une dizaine de chapitres thématiques, sur toutes les idées reçues mobilisées au sujet d’Israël.
-
«Tuer pour manger : l’abattage et la souffrance animale»
08/05/2016Depuis quelques années, des campagnes militantes demandent l’interdiction de l’abattage rituel sur le sol européen, au nom de la souffrance des bêtes en l’absence d’étourdissement préalable à leur mise à mort – un dispositif auquel les abattoirs juifs et musulmans ne recourent pas . Parallèlement, la question de la souffrance animale surgit régulièrement sur le devant de la scène à l’occasions d’opérations « vidéos en caméra cachée » menées dans les abattoirs du circuit ordinaire par des associations de défense des droits des animaux. La diffusion de ces images de maltraitance et de cruauté pousse les autorités publiques à mieux contrôler ce qui se passe dans les abattoirs, mais vise aussi à déclencher un débat plus général sur la dignité des animaux, l’abattage et la consommation de viande… Or, ce débat sur les droits des animaux et les logiques d’abattoir voit aussi mobiliser des arguments problématiques, moralement contestables, comme en atteste le maniement parfois outrancier de la comparaison avec le gén
-
A qui et à quoi sert l’idée de « morale judéo-chrétienne » ?
01/05/2016Morale judéo-chrétienne, civilisation judéo-chrétienne : ces expressions couramment employées ne vont pas de soi. D’abord parce que pendant des siècles, c’est l’hostilité, la méfiance, la concurrence intellectuelle et religieuse, qui empêchaient d’accoler juif et chrétien dans le même adjectif, même pour qualifier la morale : si la réconciliation historique et les débuts d’un dialogue judéo-chrétien respectueux ont fait émerger des points communs, ce n’est pas d’abord sur le plan théologique que l’adjectif judéo-chrétien est apparu sur la scène intellectuelle et politique mondiale… Les usages qui en sont faits aujourd’hui devraient d’ailleurs nous alerter : les racines judéo-chrétiennes de l’Europe, la morale ou la civilisation judéo-chrétienne, servent d’abord à qualifier, dans une certaine conception de l’Europe ou de l’Occident, quelque chose qui serait à défendre, contre ses ennemis supposés ou même parfois, dans certains discours publics, contre les allogènes présents sur son sol. C’est aux différents us
-
Qu’est-il juste de faire? Philosophie morale et démocratie
17/04/2016Et si le discrédit et le déficit de vitalité dont souffre notre démocratie, provenaient d’un manque de profondeur morale de notre débat public ? Et si, pour y remédier, on allait chercher sous la surface des controverses politiques, sociales et économiques du moment, les enjeux éthiques dont tout le monde pouvait s’emparer ? Et s’il fallait, pour retrouver l’art perdu du débat démocratique, laisser entrer dans l’arène publique les convictions morales - et religieuses - les plus profondes des citoyens, comme le soutient le célèbre philosophe américain Michael Sandel ? De la discrimination positive dans l’éducation au débat sur l’euthanasie, de la polémique sur les bonus des grands patrons aux questions posées par la délégation de la défense nationale à une armée de métier, des dilemmes de loyauté aux limites de la marchandisation du corps humain, Michael Sandel implique chacun par son approche exceptionnellement pédagogique. Réussissant à rendre parfaitement accessibles les enjeux les plus complexes, il repla
-
Aux frontières de l’humain : des idoles aux robots, à qui prêtons-nous le propre de l’homme ?
10/04/2016Deux récits pour mémoire. Le premier se rapporte au Golem, cette créature humanoïde d’argile créée par le Maharal de Prague pour protéger la communauté juive des pogroms : une sorte de super-robot de défense qui nous rappelle que nos créations peuvent se retourner contre nous et devenir un danger. Le deuxième récit est le midrash qui raconte comment Abraham, premier monothéiste de l’histoire des hommes, a brisé toutes les idoles du magasin de son père Terah – toutes, sauf la plus grande, entre les mains de laquelle il a alors placé le bâton, pour prendre Terah au piège de ses incohérences. La légende du Golem nous parle des robots, de leur valeur d’usage et des dangers de notre coexistence avec eux : prêter vie et semblant d’humanité à une créature inerte n’est pas sans risque. Le midrash sur Abraham critique la tendance à prêter des pouvoirs humains à des statues : en dénonçant l’infantilisme des adorateurs d’idoles et le charlatanisme de leurs prêtres, il offre à l’iconoclasme un argumentaire puissant - mai
-
Inciter à la haine au nom de l’art ? Liberté artistique et liberté d’expression
03/04/2016De l’affaire du rappeur Orelsan, relaxé récemment dans un procès qui lui était intenté pour injures et provocation à la violence envers les femmes, aux différentes polémiques à propos de films, de pièces de théâtre, de romans ou de tableaux, diffamant ou offensant les sentiments de telle ou telle communauté, en passant par certains des arguments avancés en défense du film documentaire Salafistes accusé de risquer de faire l’apologie du terrorisme… Nombre d’affaires récentes interrogent le régime de liberté propre aux œuvres d’art, quand elles donnent lieu à des dérives moralement contestables, voire pénalement condamnables. Quand la liberté de création artistique entre en interférence avec les limites posées à la liberté d’expression en démocratie (l’incitation à la violence et à la haine), comment fait-on ? Et comment discute-t-on de censure en régime de démocratie libérale ?
-
Face à la crise des réfugiés en Europe : l’économie a-t-elle des solutions aux impasses de l’éthique ?
27/03/2016Avec l’arrivée au cours des derniers mois de plus d’un million de migrants, venus pour l’essentiel de pays en guerre, l’Europe fait face à une crise humanitaire inédite. Travaillées par les populismes, les opinions publiques sont partagées entre solidarité et exaspération, pitié et panique… tandis que les instances de l’Union européennes peinent à imposer des solutions coordonnées. L’Alliance et la plupart des autres institutions juives françaises se sont associées à l’automne 2015 à la vague de solidarité nationale déclenchée par l’émotion suite à la publication de la photographie du petit garçon syrien retrouvé noyé sur un rivage turc, au nom du verset du Lévitique « tu aimeras l’étranger comme toi-même, car tu as été étranger au pays d’Egypte ». On s’est souvenu aussi de l’impératif du tikun olam, qui nous incombe, devant les malheurs d’un monde à réparer. Mais le réflexe éthique se trouve vite dépassé par la complexité de la situation. Comment respecter la dignité de ces réfugiés qui n’ont plus où vivre,
-
La religion entre espace public et espace privé
13/03/2016Depuis une dizaine d’années en France, la laïcité est devenue le terrain de débats d’interprétation souvent tendus, et de nombreux malentendus. Or, l’une des zones de confusion principales tient au statut de l’espace public. L’impératif de neutralité, qui s’impose à l’Etat laïque et à sa fonction publique, doit-il s’imposer aussi à l’espace public, à la rue – comme le soutiennent ceux qui affirment que la religion doit rester affaire purement privée? Ou l’espace public doit-il permettre la coexistence pacifique des consciences et des appartenances religieuses, ce qui peut signifier de leur laisser y occuper une place plus ou moins visible ? Autant de questions que permet de rouvrir le détour par un objet très particulier, le Eruv, auquel Astrid Von Busekist, professeur de théorie politique à Sciences-Po, vient de consacrer un livre intitulé Portes et Murs. Des frontières en démocratie (Albin Michel, 2016). Issue du Talmud et utilisée, dans certaines villes ou quartiers, pour permettre aux communautés juives o